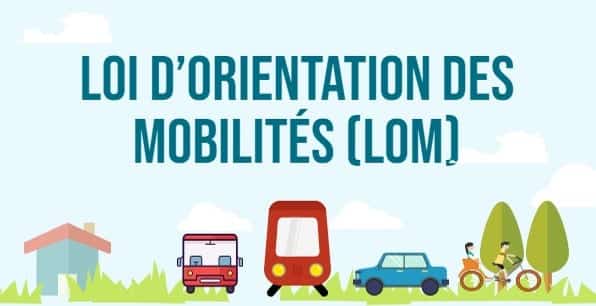- Élargissement et modernisation et l'intégration de nouveaux modes detransport : pourquoi et comment ?
- Le déplacement « intramuros » : quels enjeux… et quelles solutions avec la Loi LOM?
- La coordination comme préoccupation majeure de la Loi LOM
- Améliorer la circulation au cœur des/entre les régions : aussi une question de modernité pour la Loi LOM
- La question écologique : entre projets, encouragements et injonctions
- Les investissements prévus pour renforcer la mobilité sur le territoire français
- La LOM : un bon en avant pour la mobilité française ?
Suite à une intense discussion nationale et l’adoption de nombreux amendements par l’Assemblée nationale en septembre 2019, la loi d’orientation des mobilités (LOM) a été promulguée le 24 décembre 2019. Les événements liés au COVID19 ont peut-être ralenti certaines mises en applications, mais cela n’a pas freiné les différents projets découlant du texte législatif pour autant.
Cette loi révolutionne la stratégie de service de mobilité, avec un but clair : rendre les transports de tous les jours à la fois plus accessibles, plus économiques et plus écologiques.
À travers ce petit guide, et tout en évitant les parti pris politiques (il ne s’agit pas, par exemple, d’évaluer la différence entre promesse et concrétisation), nous allons revenir sur les axes principaux autour desquels s’articule le développement de la loi LOM. Par là-même, nous allons mettre en évidence les enjeux auxquels elle entend répondre.
En cette période particulièrement complexe sur le plan international, il est intéressant de voir quelles stratégies sont mises en place pour améliorer la mobilité des Français au niveau gouvernemental.
Élargissement et modernisation et l’intégration de nouveaux modes detransport : pourquoi et comment ?
La Loi d’Orientation des Mobilités découle notamment d’un constat : certaines activités économiques sont figées, compromises, reportées voire annulées en France faute de transports adaptés.
Cette stratégie gouvernementale vise également à réduire significativement les gaz à effet de serre et à promouvoir le développement durable dans le secteur des transports, en harmonie avec les objectifs de résilience sociale et écologique
Il s’est donc agi, pour ceux qui ont élaboré puis voté la loi, d’envisager des stratégies d’action à plusieurs niveaux.
Selon le document officiel publié par le ministère des Transports, trois objectifs centraux se dessinent :
- Optimiser l’accès à tous les territoires français. Autrement dit, faire en sorte que les déplacements au sein de l’hexagone soient rendus possibles à grande échelle et, idéalement, sans compromis.
- Donner une place de choix à la mobilité verte, dans une perspective de modernisation globale.
- Renforcer le financement, encourager l’investissement dans les solutions de mobilité quotidiennes.
Nous n’allons pas détailler chaque dispositif envisagé ou déployé par les personnes concernées. Cela dit, il serait dommage d’en rester à la surface – voici donc quelques exemples, par objectif, des pistes explorées.
Le déplacement « intramuros » : quels enjeux… et quelles solutions avec la Loi LOM?
Cette thématique mériterait à elle seule tout un dossier. Il faut dire que les implications sont très nombreuses. À l’heure actuelle, l’offre et la demande ne peuvent pas toujours se rencontrer sur le marché du travail ; et la mobilité se retrouve parfois en cause.
L’accès aux transports en commun et la mise en place d’infrastructures adaptées sont essentiels pour le désenclavement des territoires ruraux et l’amélioration du trajet quotidien domicile-travail, constituant un droit fondamental pour tous les citoyens.
Afin de traiter ce problème, plusieurs solutions ont été envisagées. La première et la plus évidente consiste à renforcer la logistique au sein des différentes collectivités. On parle alors, dans ce domaine, des AOM, pour « autorité organisatrice des mobilités ».
Toujours selon le document émis par l’État, c’est 80% du territoire qui était dépourvu d’AOM en 2017. Un score très faible, donc, qui explique en partie la naissance de la LOM.
Cette dernière a en effet permis de « faire bouger les choses », si vous nous permettez l’expression. Suite à sa promulgation, le pourcentage s’est hissé jusqu’à 50%.
L’idée fondamentale est de déléguer certaines tâches et décisions à une entité – l’AOM – spécialement dédiée. Il est à savoir que si aucune AOM n’est constituée, la région prend tout à charge. Les « dossiers » mobilité se diluent alors dans toutes les autres responsabilités déjà prises par la collectivité concernée.
Cette démarche suppose le déploiement de plusieurs avancées administratives et des agissements :
- La signature de « contrats opérationnels », avec des partenaires stratégiques, vient consolider la communication entre plusieurs entités voisines (plusieurs AOM, en l’occurrence). Cela permet de segmenter les projets d’innovation et d’amélioration.
- Il devient plus simple, en utilisant le réseau TER, d’envisager la mise en place de réseaux ferroviaires, d’axes routiers propres à fluidifier le trafic et à faire croître les opportunités de déplacements à l’intérieur, vers ou depuis les différentes régions pour les habitants.
- En ce qui concerne les trains plus précisément, les questions très complexes, discutées lors de la séance au sénat, ayant trait aux chemins de fer peuvent être examinées et traitées à une plus petite (et donc plus précise) échelle.
La coordination comme préoccupation majeure de la Loi LOM
Le rapport du gouvernement, transmis à la commission saisie pour nouvelle lecture, souligne l’importance d’une plateforme nationale pour le partage d’informations et le renouvellement des pratiques dans le domaine de la mobilité, favorisant ainsi une approche intégrale et efficace.
Au moment d’élaborer les articles de la loi LOM, plusieurs problèmes endémiques ont été constatés en France. Parmi eux, la difficulté de coordination, de synchronisation entre différents acteurs.
L’un des exemples les plus évidents concerne l’Île-de-France : l’attribution des compétences, la distribution des prérogatives n’est pas toujours claire entre la RATP et Île-de-France Mobilités.
Cela ne peut qu’entretenir une certaine confusion : certains projets sont menés en double, tandis que d’autres sont tués dans l’œuf, faute de structure.
Les termes de la législation, ou art de la loi pour l’orientation des mobilités, amenés à évoluer comme c’est le cas pour tout texte de loi, doivent permettre de définir plus clairement les affectations et les priorités. Depuis son entrée en vigueur justement, de nouvelles dispositions ont été entérinées concernant la dynamique entre la RATP et IDFM.
Bon à savoir
D’autres pions se déplacent sur l’échiquier. Parmi les avancées qu’on doit à la LOM, on constate par exemple un développement certaines des sociétés de financements ; celles qui concourent à accélérer les chantiers de construction et de rénovation. La création d’HAROPA PORT, de son côté, a permis la fusion de trois grands axes portuaires (Le Havre, Rouen, Paris) pour n’en former plus qu’une part unifiée : l’axe Seine. Là encore, il y a de quoi renforcer et faciliter les déplacements maritimes, grâce à une coordination plus étroite des acteurs.
Améliorer la circulation au cœur des/entre les régions : aussi une question de modernité pour la Loi LOM
Les « nouvelles » technologies ont résolument intégré le quotidien des Français, et cela se ressent évidemment dans le domaine de la mobilité auprès des usagers.
Les anciens PDU (plans de déplacement urbains), quelque peu en retard par rapport aux nouvelles modalités de transport (covoiturage, montée exponentielle de la mobilité douce…), sont abandonnés au profit des PDM ou « plans de mobilité », parfois appelés « plan de mobilité simplifié ».
Il s’agit, pour les autorités locales concernées, de pouvoir accéder plus facilement aux informations concernant les manques de solutions, les actions à envisager, les zones à couvrir prioritairement…
La publication (et la transmission) régulière de documents officiels permet – on retrouve encore cette idée – une fluidification des collaborations intra- et inter-régionales.
En ce qui concerne la connectivité, il a été noté que dans certains cas, la possibilité de lire les horaires, d’obtenir les informations nécessaires aux différents déplacements dans l’hexagone s’avérait compromise. La LOM a aussi été pensée pour uniformiser et simplifier la numérisation des renseignements. À terme, il faudrait que la consultation des itinéraires, par exemple, soit toujours possible au même endroit que l’achat des billets.
Autant de détails qui peuvent vraiment améliorer la dynamique de mobilité sur l’ensemble du territoire.
La question écologique : entre projets, encouragements et injonctions
Comme dans plusieurs domaines, la transition écologique et énergétique suppose un équilibre entre les projets de construction/rénovation (surtout leur mise en application), la sensibilisation et la création de nouvelles règles avec la Loi LOM.
- En ce qui concerne les projets de construction/rénovation, on apprend par exemple que 10 000 km de pistes cyclables sécurisées ont été esquissées sur le territoire entre 2017 (soit deux ans avant la mise en place de la loi) et fin 2020. La LOM n’a donc pas vraiment enclenché le processus, mais l’a largement confirmé et consolidé. Cet effort s’inscrit dans une politique ambitieuse de développement des nouvelles modalités de transport, telles que l’autopartage et l’utilisation accrue de véhicules propres, réduisant ainsi la pollution de l’air et contribuant à une qualité de vie améliorée.
- Certaines règles, notamment dans le code des transports, ont été établies pour faciliter le stationnement des véhicules. Par exemple, lorsqu’une gare est desservie par au moins une grande ligne ferroviaire, huit places « pour vélos » doivent être aménagées dans la périphérie immédiate.
Cette obligation découle d’un décret du 21 janvier 2021 ; il fait partie, comme vous l’aurez compris, des émules de la LOM. - Dès le premier janvier, les angles morts doivent être signalisés sur l’ensemble des poids-lourds du territoire, plus précisément à l’aide d’une étiquette homologuée sur la face arrière du camion. L’idée est évidemment de renforcer la sécurité sur les routes, mais aussi, en filigrane, de protéger les adeptes de la mobilité douce qui sont (malheureusement) des victimes très exposées en cas d’accident.
- Pour donner un exemple de dispositif encourageant, on peut relever la naissance du forfait mobilités durables (FMD), jusqu’à 400€/an, qui donne la possibilité aux employeurs de couvrir les frais liés à la mobilité douce (vélo, covoiturage). Il en découle, au prorata, une exemption d’impôt et des charges pour l’employeur et une exonération fiscale pour les salariés.
- La vente stimulée par la prime à la conversion et la possibilité de recharger partout sa voiture électrique, en multipliant par 5 les bornes de recharge : équipement obligatoire dans certains parkings, création d’un droit à la prise, division par plus de 2 du coût d’installation.
- Une mesure pour rendre le covoiturage comme une solution au quotidien, en permettant aux collectivités de subventionner les covoitureurs, en créant des voies réservées aux abords des métropoles, en mettant en place un forfait mobilité durable.
Et la liste est encore longue. La loi LOM permet notamment de légiférer la mise en circulation des fameux véhicules autonomes – ceux qui permettent de « conduire sans le conducteur », partiellement ou totalement. Ces véhicules sont tous électrifiés – la perspective écologique n’est donc jamais très loin.
Évidemment, une large batterie de mesures se focalise aussi sur les flottes des automobiles privées et publiques : il est question de viser la faible émission pour les transports publics, mais également lorsqu’une entreprise choisit ses véhicules utilitaires pour les employés.
Tout cela s’inscrit dans la poursuite de deux objectifs bien connus : une réduction drastique des GES d’ici 2030 (55% par rapport à 1990, selon les ambitions des membres de l’UE), et une neutralité carbone absolue en 2050, d’après le Plan Climat.
Les investissements prévus pour renforcer la mobilité sur le territoire français
Nous en arrivons au dernier volet, que nous survolons car il est assez technique : le financement. Oui, sans argent, on ne fait pas grand-chose dans ce bas monde. La LOM permet de concrétiser certains dispositifs de subventions, en leur conférant un cadre légal.
Le plafond d’investissement se situe à 13,4 milliards d’euros sur les 5 ans (2017 à 2022). Selon les données communiquées, l’augmentation enregistrée (en termes d’apports financiers) est de 40% entre la fourchette temporelle [2013-2017] et celle courant de 2019 à 2023.
Les projets visés sont très nombreux. Ils vont de l’entretien des bus à la rénovation des chemins de fer pour les 3/4 des investissements, en passant par la consolidation des structures liées au transport des marchandises.
C’est l’Agence de financement des infrastructures de France qui pilote les « opérations » et qui assure la supervision des mécanismes de subvention.
Le montant consacré par la LOM au financement des projets d’infrastructure et au soutien des entreprises innovantes dans le secteur de la mobilité illustre l’engagement du ministre des Transports à multiplier les efforts pour une mobilité plus verte et accessible à tous.
La LOM : un bon en avant pour la mobilité française ?
Nous avons mis un point d’interrogation à la fin du titre car pour apprécier les effets d’une loi, il est préférable de prendre un certain recul. C’est sur le moyen et long terme que les améliorations (ou les stagnations) pourront vraiment être jaugées.
Une chose est certaine : étudier les termes et les enjeux de la loi d’orientation des mobilités donne à constater combien la logistique des transports peut s’avérer complexe.
Il s’agit de prendre une foule de paramètres et d’intérêts en compte : budgets territoriaux, besoins démographiques, limites ou potentialités technologiques, question environnementale…
Toutes ces variables qui, espérons-le, trouveront une assise plus cohérente avec les conséquences directes ou indirectes de la LOM.